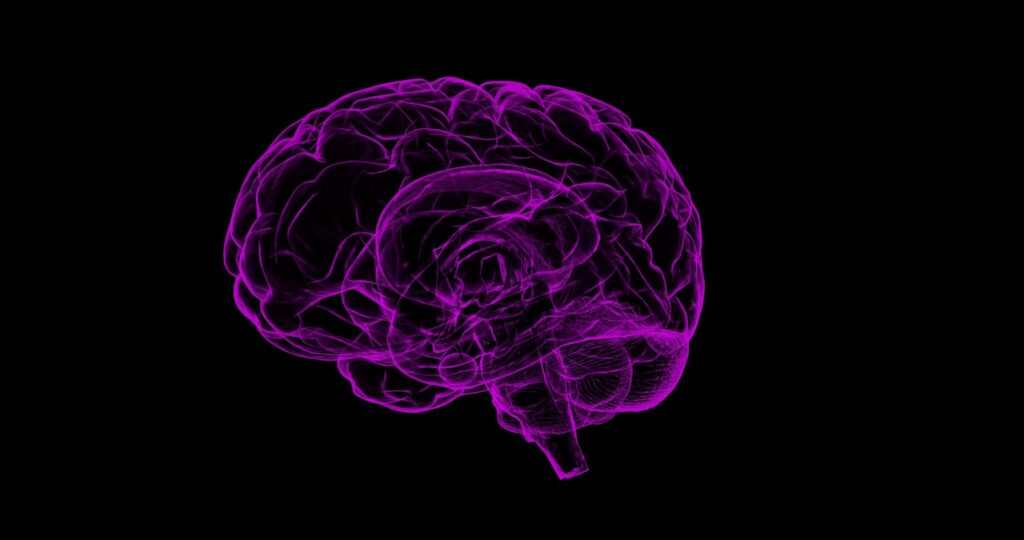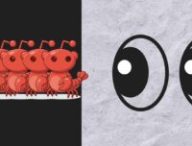Un appareil permettant de taper du texte par la simple pensée, c’est un vieux rêve d’amatrices et d’amateurs de SF. Mais pour des personnes paralysées, c’est surtout un équipement qui pourrait changer leur vie. De nombreuses équipes travaillent sur de tels dispositifs dans le monde, et l’une d’entre elles a révélé dans Nature, le 12 mai, avoir mis au point un dispositif particulièrement prometteur.
L’implant cérébral que l’équipe de Francis R. Willett (université de Stanford) a créé permet ainsi à son porteur de taper du texte par la pensée, avec une étonnante efficacité. Pour mesurer l’intérêt de cet implant, il faut comprendre les problèmes qui se posent dans ce domaine à l’heure actuelle.
Les appareils actuels ne permettent pas d’écrire vite
Tout d’abord, la plupart des appareils d’assistance à l’écriture actuels reposent sur le suivi des mouvements oculaires ou sur des commandes vocales. Or certaines personnes ont un handicap qui les empêche d’effectuer de telles actions. Elles ne peuvent donc pas s’en servir. Le suivi oculaire ne permet du reste pas de taper du texte aisément ; la vitesse moyenne est de 47,5 signes (un signe étant équivalent à une lettre ou un caractère) par minute. C’est beaucoup moins rapide qu’avec un clavier. Même sur le clavier virtuel d’un smartphone, les personnes qui tapent avec leurs deux pouces parviennent ainsi, en moyenne, à écrire 38 mots (et non pas signes) par minute.
Comme le soulignent Pavithra Rajeswaran et Amy L. Orsborn, des chercheuses spécialisées en bio-ingénierie de l’université de Washington, la frappe contrôlée par suivi oculaire a d’autres limites : « Il est par exemple compliqué de relire les passages d’un email auquel on souhaite répondre, pendant que l’on ‘tape’ avec ses yeux. » Et si les implants cérébraux ont montré qu’ils peuvent aider les personnes handicapées à réaliser certaines actions (lever un bras robotique par exemple), ils ne fonctionnent, pour le moment, pas très bien, pour taper du texte.
Analyser l’activité cérébrale pour identifier la lettre
Ces appareils ont du mal à identifier précisément à quelle lettre une personne pense, en analysant simplement son activité neuronale. Les interfaces non invasives — celles qui sont placées sur et non sous le crâne — passent souvent en réalité par des moyens détournés : elles ne prédisent pas réellement à quelle lettre la personne pense, mais analysent sa réaction lorsque des lettres sont mises à défiler devant elle, sur un écran séparé. Le cerveau a une réaction spécifique lorsque la lettre désirée est présentée : c’est comme cela que l’interface comprend que c’est la bonne.
Les interfaces invasives ont, elles aussi, de nombreuses limites, précisent les chercheuses Pavithra Rajeswaran et Amy L. Orsborn : « La plus aboutie permet à une personne de contrôler un pointeur pour sélectionner des lettres, et offre une vitesse de frappe de 40 signes par minute. » L’appareil développé par Francis R. Willett et ses collègues est très différent. Leur interface — de type invasif — analyse l’activité neuronale générée par la personne, lorsqu’elle imagine écrire une lettre. Comme le note Nature, créer un tel outil était ardu. Il est en effet difficile de savoir, avec précision, à quel moment la personne commence son essai.
Pour contourner ce problème, F. Willett et ses collègues ont eu l’idée de se servir d’un algorithme habituellement utilisé pour la reconnaissance vocale. Celui-ci leur a permis d’estimer, en fonction de l’activité neuronale, à quel moment la personne essayait d’écrire un caractère. Grâce à quoi, ils ont pu constituer des sets de données rassemblant les schémas d’activité cérébrale correspondant à chaque lettre, et entraîner leur algorithme de classification.
L’équipe a également dû trouver un moyen d’augmenter le nombre de données d’apprentissage. Il aurait été fatigant — et très barbant — pour la personne expérimentant le dispositif, de passer des heures à s’imaginer écrire des lettres de l’alphabet, pour produire suffisamment de données. L’équipe avait cependant besoin d’un volume conséquent pour entraîner correctement son dispositif. « Les auteurs ont résolu ce problème grâce à une approche appelée l’augmentation de données. Les schémas d’activité cérébrale générés par les participants sont utilisés pour produire des phrases artificielles, sur lesquelles on va entraîner le réseau neuronal », précise Nature.
Taper à une vitesse deux fois plus élevée
Les résultats de ces efforts sont impressionnants. L’algorithme mis au point par Willett et ses collègues fournit la bonne réponse dans 94 % des cas. En ajoutant à leur outil des modèles de prédiction textuels (comme ceux qui proposent des suggestions de mots dans un email ou un message), l’équipe a même réussi à atteindre un taux de réussite de 99 %. La personne qui participait à l’essai a réussi à taper de manière exacte à une vitesse de 90 signes par minutes.
Les scientifiques ont noté que certaines lettres qui s’écrivent de manière relativement similaire (le V et le U par exemple) étaient plus complexes à classifier. Il faudra donc vérifier que leur approche fonctionne aussi bien sur des langues comportant beaucoup plus de lettres, parfois très similaires, commentent les chercheuses de l’université de Washington : si l’anglais n’a que 26 lettres, le Tamoul par exemple en a 247 dont de « nombreuses très similaires ».
Les implants cérébraux doivent encore prouver leur innocuité
L’équipe de Willett a néanmoins fait une découverte fondamentale, estiment-elles dans Nature : l’activité cérébrale liée à l’écriture manuscrite est « plus facile à classifier » que l’activité générée par des signes élaborés avec des lignes droites.
Il reste bien sûr de nombreuses étapes à contrôler avant qu’un tel dispositif puisse éventuellement être commercialisé. On vous en parlait il y a peu, lorsqu’Elon Musk faisait une promo un peu trop enthousiaste de son implant cérébral (qui a permis à un singe de jouer à Pong avec son esprit).
Les implants cérébraux ont un potentiel extraordinaire, mais soulèvent de nombreux défis techniques. L’innocuité à long terme d’un dispositif placé sous le crâne n’est pour l’heure pas du tout garantie — et le danger serait encore plus élevé si le porteur venait à recevoir un choc sur la tête. Par ailleurs, les interfaces cerveau-machine invasives tendent à devenir moins efficaces à mesure que le temps passe. Or elles sont aussi très complexes à changer (cela nécessite une opération). Des équipements de ce type devront donc prouver que leurs bénéfices sont élevés, et leurs risques réduits au maximum, avant d’être éventuellement autorisés sur le marché.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !