Véritable OVNI — et phénomène d’édition –, Lastman, la BD de Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville, compte aujourd’hui également un préquel en version animée et un jeu vidéo, LastFight.
Le dessin animé pour adultes au ton décalé et au rythme haletant — sauvé en cours de production par le crowdfunding des fans après le retrait d’un investisseur — se penche sur la jeunesse de Richard Aldana, le colosse connu pour son franc-parler et ses talents de boxeur…
Un an après leur diffusion sur France 4, les 26 épisodes de la série animée sont aujourd’hui disponibles en DVD et Blu-Ray. Jérémie Périn, réalisateur, et Laurent Sarfati, directeur d’écriture, reviennent avec enthousiasme sur les coulisses de ce projet, leurs influences, et la complémentarité entre les deux œuvres.

Laurent Sarfati et Jérémie Perin
Vous n’aviez pas l’intention de réaliser une adaptation classique de Lastman, tome par tome. Mais aviez-vous dès l’origine l’idée de signer un préquel ?
Jérémie Perin : C’est vrai que personne — que ce soit les auteurs de la BD ou Laurent et moi — ne voulait faire une adaptation de la BD. La structure des volumes ne permettait pas vraiment d’entrer dans le format qui allait être le nôtre — 13 minutes par épisode — et il aurait de toute façon fallu remanier énormément.
On a donc préféré faire une autre histoire : l’idée était de faire un préquel pour que la série n’entre pas en conflit avec la suite de l’histoire de la BD, dont les auteurs ont une idée générale mais pas tous les détails. Le préquel est arrivé assez vite, je crois que c’est Bastien Vivès qui en a eu l’idée… Et puis on a défini l’arche dramatique et narrative de la série avec les auteurs.
On est partis du principe que Richard n’avait pas tellement évolué ! (rires) En gros, les différences tiennent à des détails, comme le fait qu’il fume dans la BD mais pas dans la série ! On comprend par contre la raison pour laquelle il est devenu champion, pourquoi il s’est lancé dans cet univers alors qu’il n’a pas vraiment un caractère compétitif. Mais sa nature profonde reste la même.

À l’inverse, est-ce que les auteurs vous ont interdit de traiter de certains éléments pour pouvoir les introduire dans de futurs albums ?
Jérémie Perin : Non, pas du tout. En plus, on a réalisé un épisode qui raconte comment Richard rencontre Dave [son mentor] et découvre la salle d’entraînement, la boxe… Les auteurs n’avaient eux-mêmes pas encore prévu de flashback là-dessus donc on a pu inventer tout en restant raccord avec ce qu’ils s’étaient imaginés eux-mêmes. Ça a été fait ensemble, par l’entremise de Balak et des autres scénaristes.
La particularité de la série, c’est qu’elle n’était pas du tout prévue à la base, les auteurs de Lastman ne se sont pas lancés dans un projet transmédia avec un planning secret « conquérir le monde et tous les médias avec du Lastman partout ! » L’occasion fait vraiment le larron.
On a l’impression que le jeu vidéo influence grandement la série, entre l’ambiance de Paxtown qui rappelle celle de GTA et l’introduction de Richard en vue subjective…
Laurent Sarfati : L’influence des jeux vidéo est indéniable. Je pense notamment à la scène dans les égouts, inspirée de Left 4 Dead…
JP : Oui, clairement ! On a même repris la topologie d’un niveau de Left 4 Dead, simplement parce que la configuration de ce passage était dingue… Et c’était un clin d’œil vu qu’on y a tellement joué, Laurent et moi.
Mais il y a plein d’influences venues du jeu vidéo, des astuces tirées de vieilles cinématiques de jeux d’arcade, d’introductions à la Street Fighter… Et même le principe des sprites [un élément graphique qui se déplace sur le décor] peu animés mais efficaces.
LS : Gobi [Baptiste Gobert, l’un des character-designers de la série] était chargé de créer les personnages avec Jérémie et Emmanuelle Fleury. Au début, ils ne se comprenaient pas très bien et ils ont fini par réaliser qu’ils venaient de deux écoles de jeux vidéo différentes… c’est à partir de ce moment-là qu’ils se sont compris !
JB : En fait, j’avais lancé le style de dessin de la série et quand Gobi a pris le relais pour créer des catcheurs, des roitelets [les créatures affrontées par Richard Aldana], etc., il leur attribuait des proportions boursouflées : grosses mains, gros pieds… Dès que je lui ai dit : « Non, c’est trop Capcom et moi je suis plus SNK », là, il a parfaitement compris !
Pourquoi avoir choisi un format aussi court, à base d’épisodes de 13 minutes ?
JP : C’est dû à la fois au budget et à l’envie de rester longtemps à l’antenne : en réalisant plein d’épisodes, on a l’opportunité de les étaler et de la faire durer longtemps. C’est cette équation-là qui a abouti à 26 épisodes de 13 minutes.
LS : En simplifiant, on a eu le choix entre faire 13 épisodes de 26 minutes ou 26 épisodes de 13 minutes. On avait envie de faire une saga, quelque chose de feuilletonnant avec une grande arche. En tant que spectateur, on trouve toujours ça frustrant quand une série n’a pas assez d’épisodes, comme la dernière saison de Game of Thrones.
En plus, le monde de Lastman est tellement riche qu’on sentait ce besoin de disposer d’un certain nombre d’épisodes pour être feuilletonnant.

La plus grosse différence narrative avec la BD tient justement à ce découpage narratif alors que chaque volume se lit généralement d’une traite en l’absence de chapitres…
JP : C’est ce que je disais : si on avait dû subdiviser les volumes BD en épisodes, ça aurait été compliqué. La temporalité n’est pas du tout la même. Quand on doit faire rentrer une structure scénaristique dans des épisodes de 13 minutes, on est obligé de passer par 3 actes différents, qu’on n’a pas forcément dans la BD.
LS : L’écriture pour l’audiovisuel est beaucoup plus normée que dans la BD, où on écrit au fil de la plume. La BD, c’est un peu comme raconter une histoire à un gamin qui est en train de s’endormir : il peut s’endormir avec (ou pas d’ailleurs) mais le fil narratif est moins rigide.
On a fait rentrer au forceps une histoire C en plus des histoires A et B
JP : La temporalité est imposée en audiovisuel alors qu’en BD on peut faire des grandes cases et des petites, avoir l’impression de gérer le rythme… alors qu’en fait c’est le lecteur qui décide de rester 2 secondes ou 3 heures sur une case.
LS : La passivité du spectateur qui regarde la télé impose aux gens qui lui proposent le programme une certaine rigidité pour le tenir éveillé. On est obligé d’avoir des actes, des pivots, des rebondissements très réguliers. Si les histoires semblent speed — et elles le sont ! –, c’est parce qu’avec une histoire normale de 13 minutes, vous avez une histoire A et B. Dans Lastman, on a réussi à faire rentrer au forceps une histoire C pour tenir plusieurs intrigues à la fois.
La série repose justement sur un mélange permanent des genres et registres : ce jonglage a-t-il été délicat à réaliser ?
LS : C’est ce qu’on avait envie de faire !
JP : Le plus difficile, ça a peut-être été de faire du registre dramatique mais ça reste toujours assez simple d’y glisser une touche d’humour. Le pathos peut avoir un côté ridicule ou bizarre, qui vire au « marrant ». Certains moments dans la série tiennent le drame sur la durée et c’est ce dont je suis le plus fier : on ne voulait pas être dans l’ironie permanente et le recul.
LS : L’un de tes plus grands regrets, c’est quand, après un moment dramatique, tu as laissé une vanne de Richard qui lance un truc du style « Ah ah ah ! En fait, c’est pas grave ! » Je pense à la scène du duel à trois où quelqu’un meurt, ce qui choque beaucoup Richard. Mais juste après, il balance : « Je prendrais bien une bonne bière ! » (rires)
Ce qui est difficile, quand vous voulez jongler entre les genres, c’est de conserver la cohérence des personnages. Quand vous les faites passer de la tristesse à la colère — surtout quand ça va très vite –, le personnage risque de perdre de sa cohérence et de sa crédibilité auprès du spectateur.

Les noms d’épisode sont tout un programme à eux-mêmes (comme « Sors de ma mère ! »). Comment avez-vous procédé pour choisir ces citations ?
LS : J’avais sélectionné les bouts de dialogue qui serviraient de titre. Mais après coup, quand [l’équipe] a réalisé les animatiques, on a réalisé que la plupart des titres que j’avais choisi arrivaient juste avant ou juste après que le titre de l’épisode s’affiche, donc ça faisait un effet bizarre… Plusieurs ont dû être modifiés à cause de ça.
JP : À certains moments, on a d’ailleurs dû changer le titre parce que certaines scènes du storyboard étaient supprimées ou des dialogues étaient modifiés. Mais il ne fallait pas non plus que les titres spoilent l’épisode… c’était tout un jeu entre nous.
Laurent, Balak affirme qu’à votre première rencontre, il vous a trouvé odieux au point de vouloir vous mettre son « poing dans la gueule ». Quelle est votre version des faits ?
JP : C’est comme ça dès qu’il rencontre quelqu’un !
LS : Je pense que Balak fait référence au moment où je lui ai dit : « Quand on écrit une BD, surtout comme Lastman, on écrit l’histoire au fur et à mesure et c’est un peu le bordel… » Ça l’a vraiment énervé en tant que scénariste principal de Lastman, lui qui se prend la tête pour assurer la cohérence, glisser des rebondissements…
Ça l’a vraiment agacé que je dise ça mais cinq minutes après on était les meilleurs copains du monde ! Tout simplement parce qu’on s’est rendu compte qu’avec les autres — les auteurs de la BD, Jérémie et moi –, on avait une référence en commun : le but poursuivi par les héros de Bakuman [le manga de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba qui raconte le quotidien de deux auteurs de manga déterminés à percer dans le milieu].
Eux, ils faisaient leur BD avec le but ultime que ce soit transformé en anime, et nous, quand on lisait les Bakuman, on se disait : « C’est nous, c’est notre vie ! » On s’est tout de suite dit qu’on allait essayer d’apprendre les uns des autres pour faire les meilleures choses possible.
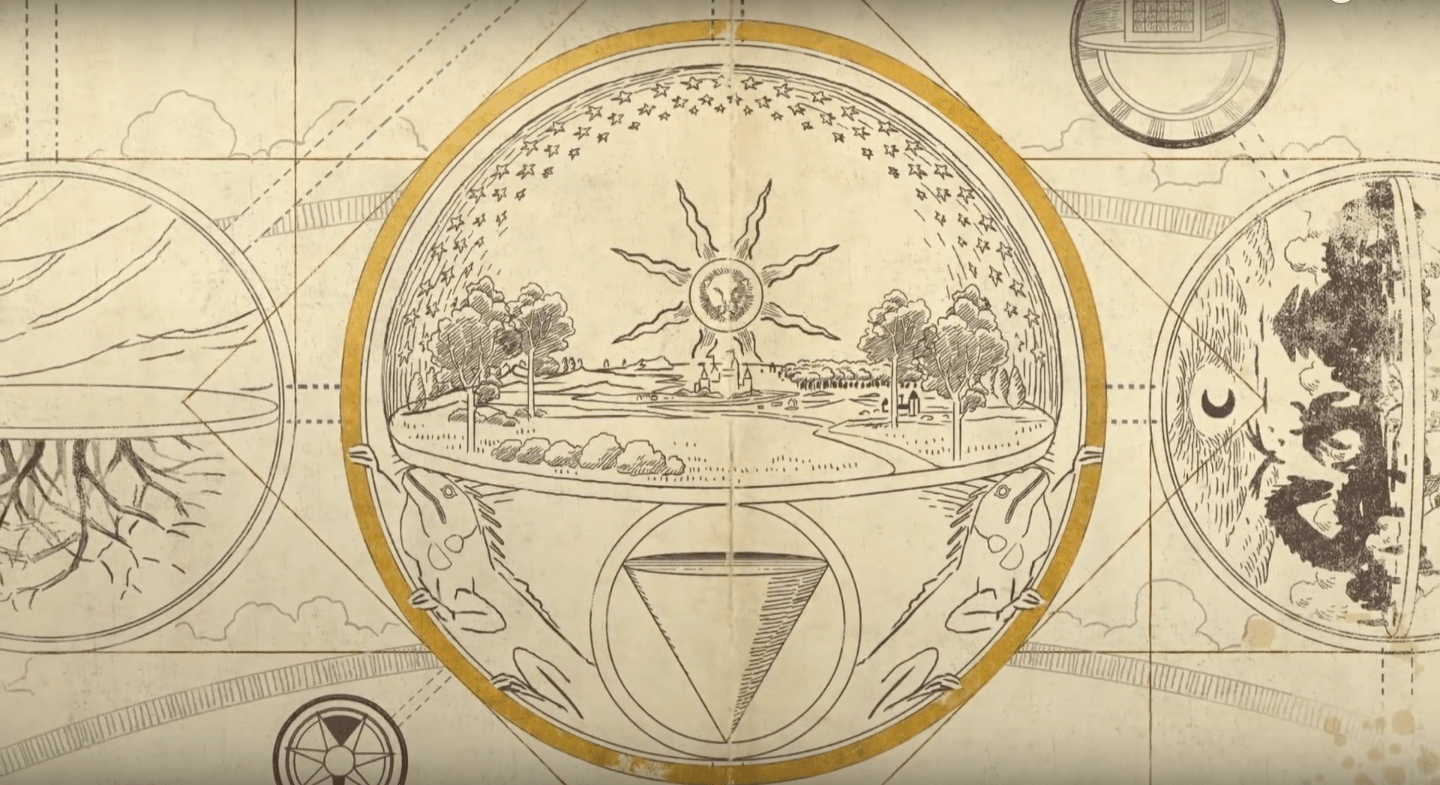
Vous vous êtes inspirés de l’animation japonaise tout en tentant de créer vos propres trouvailles d’animation : vous avez des exemples en tête ?
LS : Les influences, il y en a un milliard ! (rires)
JP : C’est difficile parce qu’il s’agit souvent beaucoup de choses en même temps. L’influence japonaise est surtout dans les techniques d’animation, l’économie de moyens…
Par exemple, j’ai déjà beaucoup vu dans l’animation japonaise l’insertion d’un gros plan qui va très vite et s’achève sur un gros plan plus large, avec un dézoom arrière très vif, qui donne une impression d’efficacité avec très peu de dessins au final. Ça a un impact visuel évident, qui dynamise la narration.
Un changement de plan ou un mouvement de caméra remplacent souvent le mouvement du personnage lui-même. S’il s’asseoit d’un coup, on va par exemple le dessiner directement assis mais faire descendre la caméra de haut en bas, comme si elle l’avait raté tellement il s’est assis rapidement. On sous-entend un mouvement sans le montrer.
L’animation japonaise a tendance à être standardisée pour l’efficacité
LS : La grosse différence avec l’animation japonaise, à mon sens, c’est l’effort que tu as fait sur ta mise en scène : les choix de caméra, le mouvement, qui disent des choses, alors que dans l’animation japonaise, même s’ils sont plutôt forts, il y a un calcul très intelligent sur l’animation. Et tu as ajouté une patte de réalisation qui vient plus du cinéma.
JP : Peut-être, en tout cas c’est ce que je voulais. Mais c’est vrai que l’animation japonaise a tendance à être très standardisée — pour l’efficacité avant tout — sans se poser de question sur le sens de la mise en scène : c’est souvent une succession de champ/contrechamp…
En toute objectivité, pour découvrir Lastman aujourd’hui, si on ne connaît ni la série ni la BD, par quel support vaut-il mieux commencer ?
LS : C’est pareil ! C’est fait pour être lu et vu dans les deux sens.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !











