« On vend un concept moral » : quand le féminisme devient un business sur Instagram
« Bon.
Ces mots, postés le 21 juin 2022 sur Instagram par Léa, créatrice du compte Merci Beaucul, révèlent déjà d'eux-mêmes certaines conséquences délétères de la professionnalisation des influenceuses engagées sur les réseaux sociaux, se revendiquant des mouvements sex-positifs et/ou body-positifs. Un enjeu qui reste, à ce jour, tabou*.
De fait, le contenu engagé sur les questions féministes, notamment relatives à l’acceptation de son corps et à la libération sexuelle, se multiplie sur le réseau social depuis quelques années. Historiquement, l’enjeu militant était central, comme nous le rappelle la journaliste économique Léa Lejeune (autrice de l’essai Féminisme-washing : quand les entreprises récupèrent la cause des femmes chez Seuil) : « Avec les réseaux sociaux, les militant·es se sont mis à vulgariser des notions de manière différente. Ça a énormément pris. Comme les mouvements féministes étaient sous représentés dans les médias traditionnels, ça a été un ressort pour amplifier ces discours. »

Rapidement, la nature de ces comptes pédagogiques évolue : les lignes éditoriales, de plus en plus floues, alternent entre information, sensibilisation… et commercialisation. Placements de produits, partenariats, jeux concours, codes promo : les marques s’allient de plus en plus avec les influenceuses pour étendre leur périmètre de vente, et ces dernières multiplient souvent les rôles pour assurer leurs revenus.
Pourtant, ces espaces de sociabilité et d’apprentissage en ligne constituent des lieux de transmission de l’information importants, et aident un nombre considérable de personnes à envisager plus sereinement leur rapport au corps ou à la sexualité. Une dynamique positive qui semble a priori incompatible avec un matraquage commercial.
Lorsque le féminisme devient un métier
Comment expliquer cette porosité grandissante entre les contenus éducatifs et commerciaux sur les réseaux sociaux ? « L’activité de créatrice de contenu est très chronophage, et on sait comment fonctionnent les algorithmes, qui demandent de produire du contenu de façon très régulière pour qu’il soit poussé », nous répond Léa Lejeune. « Comme cela prend de plus en plus de temps aux influenceuses, elles ont dû se professionnaliser. Or, quand on se professionnalise sur des enjeux de lutte sociale et qu’on ne passe plus par les milieux associatifs qui font tampon, on n’a pas d’autre choix que de devenir une entreprise. » Selon elle, la dynamique de commercialisation de certains comptes féministes pourrait montrer « la limite du militantisme quand il devient l'activité principale des personnes ».

Du pain bénit pour les marques, qui y voient une formidable opportunité économique : 58 % des Français et des Françaises se diraient féministes selon un sondage Harris Interactive de 2018. « Les marques réalisent que c’est un bon moyen de communiquer, de faire passer des engagements, de convaincre un jeune public, notamment féminin, plus sensibilisé à ces questions », analyse la journaliste.
Léa, du compte Merci Beaucul, abonde en ce sens : « En tant que créatrice, je me rends compte de l’énorme charge de travail que c’est, des semaines à rallonge, de la charge émotionnelle que ça représente, les questions étant très intimes, des contraintes de l’algorithme… Je comprends l’importance des partenariats qui permettent aux abonné·es de continuer d’avoir accès à du contenu gratuit. » Mais c'est aussi en tant qu'utilisatrice qu'elle dit ressentir une « énorme lassitude » face aux contenus sponsorisés et à la mécanique de consommation « impulsive » qu'ils génèrent.
« Les abonné·es vont beaucoup plus se fier à l’opinion de la personne qu’ils suivent depuis longtemps, dans une certaine intimité. »
Cette stratégie de communication est d’autant plus pérenne que la recommandation directe présente un avantage de taille par rapport à la régie publicitaire traditionnelle. Elvire Duvelle-Charles, militante sexo et autrice de Féminisme et réseaux sociaux : une histoire d’amour et de haine (éditions Hors d’Atteinte) nous explique que « ce que les marques font en choisissant de passer par des influenceuses plutôt que par un système traditionnel de publicité, c’est utiliser la confiance existante entre la créatrice et sa communauté ». La clé de voute, c'est la relation de confiance : « Les abonné·es vont beaucoup plus se fier à l’opinion de la personne qu’ils suivent depuis longtemps, dans une certaine intimité. »
Un fonctionnement marketing qui amène à une dérive majeure : celle de devoir toujours plus engranger de profit pour tenir la cadence de publication et plaire aux algorithmes -- et donc aux marques, vérifiant systématiquement les taux d’engagement du contenu créé, avec des conséquences certaines sur la qualité du message produit. C’est ce qu’explique Elvire : « Pendant les entretiens réalisés avec les créatrices de contenus pour écrire mon livre, je me suis rendu compte qu’elles ne produisaient plus le contenu qui les intéressait, mais le contenu qui intéressait l’algorithme. »
Une évolution de l’usage des réseaux confirmée par Léa Lejeune : « Ces deux intérêts contraires, d’un côté militant et de l’autre marketing, se sont rejoints. Ce que ça donne, c’est une réappropriation des discours militants par le capitalisme, par les marques. »
L'équilibre difficile avec les risques économiques
Parmi les marques dont parle la journaliste économique, on compte également celles des influenceuses elles-mêmes. C’est le cas de Louise Aubéry, créatrice du compte My Better Self et qui, forte de ses 537 000 personnes abonnées, revendique un contenu body-positif. Dans la foulée de son activité sur les réseaux sociaux, elle lance en 2021 « Je ne sais quoi », sa marque de vêtements « éthique et inclusive » qui « s’adresse à toutes les tailles ». Pourtant, le catalogue s’arrête au 48.

Nous pouvons aussi citer Meuf Paris, tenu par Claire Suco, qui a accepté de répondre à nos questions. La marque, proposant notamment de la lingerie menstruelle, est régulièrement épinglée par les « fat activists » sur les réseaux sociaux pour n’avoir que très peu de stock grande taille, bien qu’elle se revendique comme engagée et défende clairement un positionnement féministe.
« Le but de Meuf Paris est de donner du pouvoir aux femmes à travers les vêtements », nous explique Claire Suco. Lorsqu’on l’interroge sur les critiques formulées à l’encontre de sa marque pour ces raisons, elle se défend : « Meuf Paris est engagée depuis ses débuts de manière sincère pour plus d’inclusivité, de diversité et d’universalité. Ce que nous avons accompli avec très peu de moyens, à savoir proposer pour certains modèles jusqu’à 14 tailles, c’est du jamais vu pour une entreprise si petite. »
Elle nous confie que cela s'est parfois fait au détriment de la santé économique de la marque. « Pour être très concrète, les culottes de règles que nous avons fabriquées il y a deux ans en taille 56 sont toujours en stock. Nous ne sommes pas une grosse marque, chaque pièce de stock qui dort est dangereuse pour nous. Je comprends que certaines personnes puissent se sentir exclues et frustrées. Mais je trouve ça vraiment dommage de s’attaquer à des petites marques comme la nôtre qui essayent pourtant de faire au mieux. »
Léa Lejeune revient sur ce positionnement : « Si ça représente un petit pourcentage de fabrication des vêtements, ça veut dire que la marque doit commander du stock à part. Elle n’a pas d’intérêt à avoir en stock des vêtements grandes tailles, pour cette raison. En même temps, si elle s’ancre dans un verbatim féministe, elle a intérêt à communiquer sur les réseaux qu’elle en dispose. » Cela dénote un difficile équilibre entre la gestion de stock et la volonté de faire mieux, et, souvent, « c’est l’intérêt économique qui prime sur l’intérêt militant ».
Le business du coaching
La cadence importante de placements de produit amène par ailleurs les créatrices à devoir se diversifier afin de ne pas lasser leur audience. « Les entreprises cherchent évidemment à nous faire accumuler, car c’est dans leur intérêt économique », rappelle Léa Lejeune. Afin de ne pas proposer les mêmes produits en continu, les influenceuses vont alors ouvrir d’autres champs d’activité, en plus de nouveaux partenariats.
On compte, par exemple, l’activité de coaching, qui présente l’avantage de réhumaniser les relations entre l’influenceuse et les personnes abonnées. Une dérive toutefois problématique, selon Elvire Duvelle-Charles : « Je trouve ça dangereux quand les personnes qui font des partenariats rémunérés s’affichent comme des expertes. Avant, les comptes sexo reposaient beaucoup sur la récolte de témoignages des abonné·es, ils étaient dans une position de non-expertise. Il y a une professionnalisation de personnes qui passent des diplômes plus ou moins reconnus par l’État et s’affichent comme expert·es. »
Est-ce à dire qu'il y a un conflit d'intérêt ? « Si tu te dis sexothérapeute et que derrière, tu vends des savons pour les vulves ou que tu promeus un produit grâce auquel ta vie sexuelle sera soi-disant améliorée, il y a une ambiguïté », estime Elvire Duvelle-Charles.
C’est le cas d’Amal Tahir, influenceuse sex-positive et body-positive à la tête d’un compte suivi par près de 85 000 personnes, qui indique sur son site être « coach en neuroscience » et propose d’aider les femmes à « développer leur énergie sexuelle et à accéder à un certain mindest ».

Léa Lejeune confirme cette dynamique et parle quant à elle de « gourouisation » des milieux féministes en ligne : on aime un produit, car telle personne en fait la promotion, et non parce qu'on en a besoin.
Mais cela amène aussi à faire évoluer la nature même des partenariats, de plus en plus éloignés des sujets de prédilection des créatrices de contenu. Amal Tahir a par exemple posté le 21 juin 2022 en story de son compte Instagram un partenariat avec l’entreprise de fenêtres Velux… en défendant « les impacts positifs de la lumière naturelle sur la sexualité et la confiance en soi ».

Même système sur le compte d'Orgasme et Moi, suivi par 629 000 personnes, qui publiait le 27 avril 2021 un jeu-concours avec Moulinex afin de faire gagner des robots de cuisine à son audience.
Le commerce de la vulnérabilité
Quelles sont les conséquences de cette omniprésence des marques sur les abonnées vulnérables, venues chercher du contenu pédagogique pour répondre à leurs questionnements et souffrances ? « La publicité liée aux valeurs, notamment féministes, que ce soit sur des questions de sexualité ou d’acceptation du corps, repose toujours sur le même levier : on te vend un produit ou un service avec une promesse psychologique », répond Léa Lejeune. Elle livre l'exemple du lubrifiant écolo et féministe : l'idée n'est pas tant de vendre un meilleur lubrifiant, mais un produit qui va « rendre ta sexualité meilleure ». Résultat, « on ne vend plus d’objet fonctionnel, on vend un concept moral. Mais parfois, ce dont les personnes ont besoin, c’est simplement d’informations, voire d’accompagnement thérapeutique », constate la journaliste.
Ces business models questionnent, puisqu’ils reposent sur la guérison des insécurités créées par le patriarcat et le capitalisme eux-mêmes. Et dans ce cas de figure, les formations en ligne constituent un formidable moyen d’exploiter le filon. Récent exemple en date, Masha Sexplique, qui compte 110 000 personnes abonnées, s’allie avec le compte Wicul (164 000 abonné·es) afin de proposer un atelier pour « apprendre concrètement comment branler et sucer un pénis » à 19 euros par tête, grâce auquel on peut notamment apprendre à faire une gorge profonde.
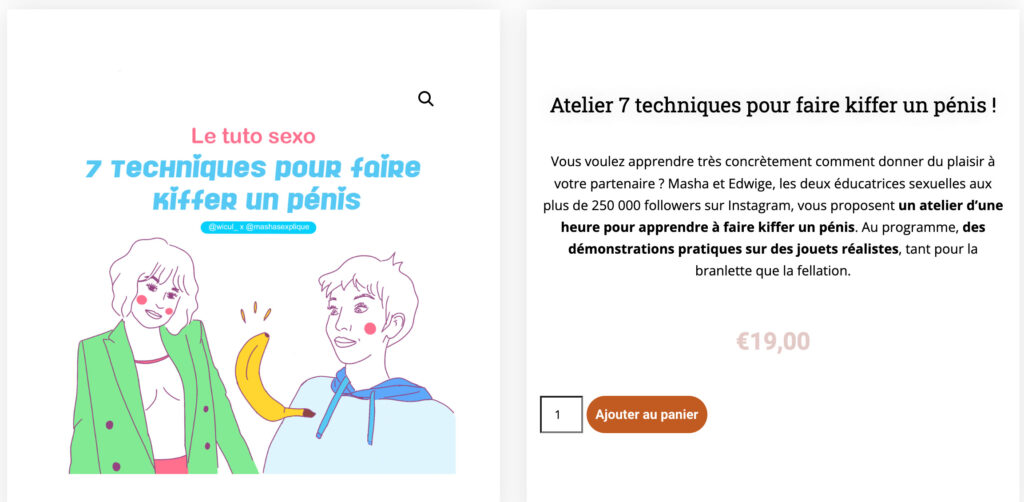
Léa de Merci Beaucul alerte sur la responsabilité des créatrices : « Beaucoup de jeunes consomment ce contenu éducationnel qui fait figure d’autorité. On peut se retrouver sous plein de nouvelles injonctions qui sont sommes toutes bienveillantes, mais quand même des injonctions. » Elle relève qu'une question récurrente est « est-ce que c'est normal si... ? », ce qui crée le risque de générer de nouvelles normes.
Parmi les solutions, l'indépendance financière ?
Face à ces différents constats, quelles perspectives envisager et comment trouver l’équilibre entre financement d’un travail souvent réalisé gratuitement, cohérence avec le message de base et respect de l’audience ? Léa Lejeune rappelle que la limite est ténue entre faire preuve de créativité, donner du sens et détourner les choses pour vendre des produits ou service. Mais elle pense aussi qu'il existe des solutions. « Il faut garder du contradictoire et mettre en concurrence les services. Il devrait y avoir un conseil de déontologie des influenceur·euses, des formations à la déontologie… On ne peut pas vendre n’importe quoi à n’importe qui, surtout quand la mention de partenariat rémunéré n’est pas toujours clairement affichée ! », estime-t-elle.
Pour Elvire Duvelle-Charles, il faut aussi se pencher sur la question des autres modes de financement. « Pour moi, la meilleure option, c’est évidemment le modèle de l’indépendance financière. Être financé·e par son lectorat, ou travailler de manière bénévole. Mais c’est un objectif difficilement atteignable. C’est pour ça qu’il est important, quand on en a les moyens, de faire l’effort de financer les acteur·ices que l’on soutient. » Bien qu'elle-même fasse des partenariats nombreux, elle cherche aussi à diversifier ses sources de revenus : « J’ai lancé un Book Club sur Patreon, je suis chroniqueuse pour Hotline, un podcast Spotify qui parle de cul... », rappelle-t-elle.
Ces discussions collectives montrent la nécessité de questionner les dérives inhérentes à des modèles de militantisme ne pouvant exister qu’au travers du prisme commercial. La marchandisation des enjeux sociaux a pour conséquence, selon Léa Lejeune, de « dépolitiser les luttes féministes » et d’en faire une simple question de développement personnel à laquelle seul le marché pourrait répondre.
*Les comptes My Better Self, Wicul, Masha Sexplique, Amal Tahir et Orgasme et Moi, évoqués dans cette enquête, n’ont pas donné suite à nos sollicitations ou n’ont pas souhaité répondre aux questions.